Bienvenue sur le Blog MONARKIT, nous vous souhaitons une excellente lecture !
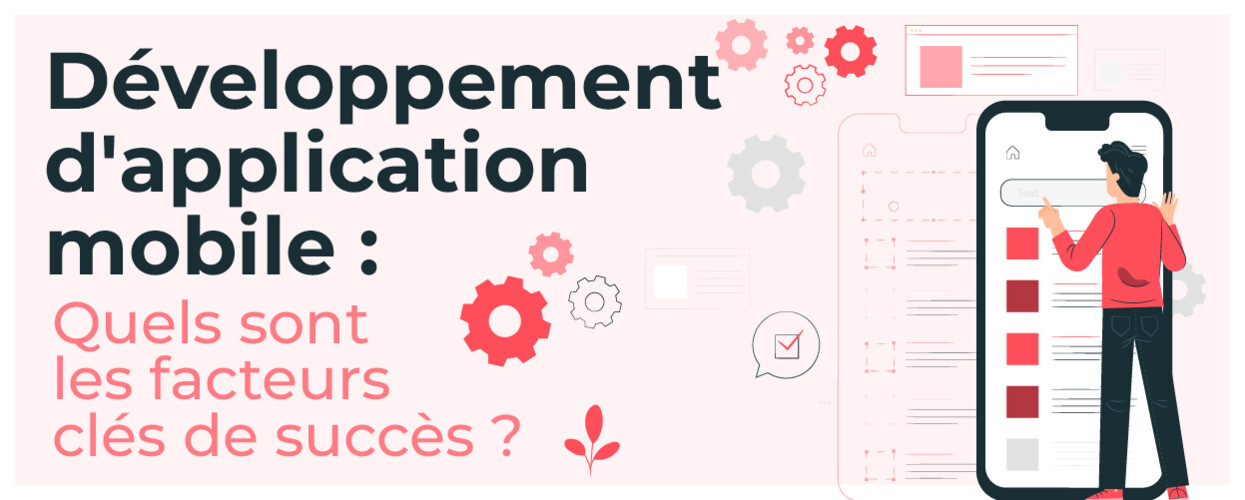
Développement d'application mobile : quels sont les facteurs clés de succès ?
Publié: 22/02/2024Les applications mobiles constituent aujourd’hui les nouvelles vitrines des marques. Puis, la plupart du temps, il s’agit du principal point d’entrée de leurs clientèles, que...
Lire la suite
Le design graphique d’un site web : pourquoi est-ce important ?
Publié: 08/02/2024La performance et la qualité d’un site internet dépendent de nombreux paramètres. Figurant parmi eux, le design graphique se revêt d’une importance particulière en raison de ...
Lire la suite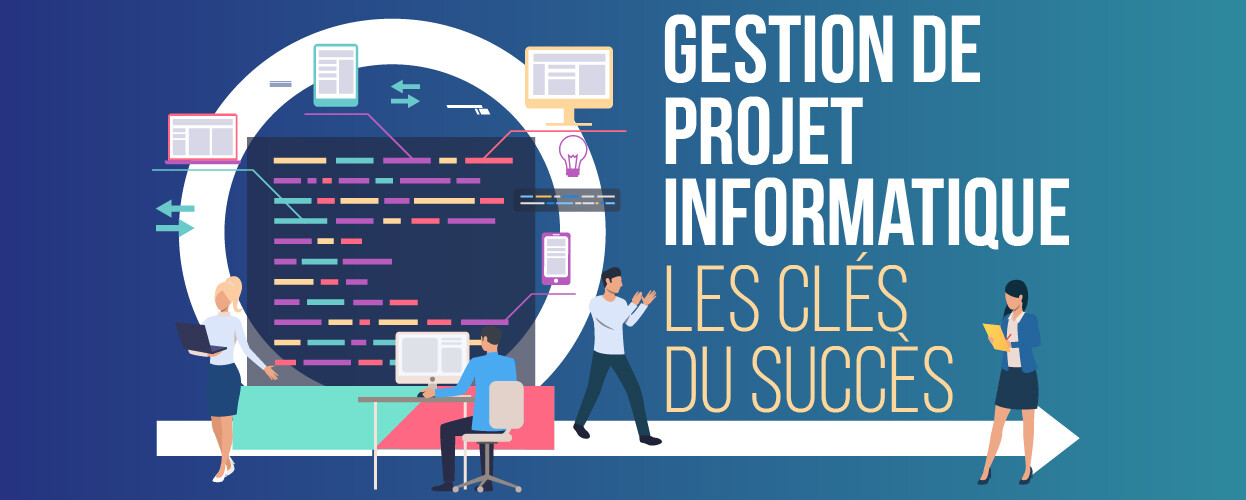
Gestion de projet informatique : Les Clés du succès
Publié: 30/01/2024La gestion de projet informatique est une discipline essentielle dans le monde complexe et dynamique de la technologie. Que ce soit dans le cadre du développement d'une nouvelle ...
Lire la suite
L'Assurance Qualité Logicielle : Pilier Indispensable pour le Succès d'un Projet Symfony
Publié: 23/01/2024Dans le domaine du développement web, il est essentiel d'assurer la qualité logicielle afin d'obtenir un bon fonctionnement des applications. Le framework PHP Symfony est ...
Lire la suite
Comment effectuer une mise à jour de Symfony?
Publié: 19/01/2024Symfony est un framework web open source écrit en PHP, utilisé pour développer des applications web. Il offre une structure modulaire, des composants réutilisables et suit le ...
Lire la suite
LESS vs SASS : Choisissez le meilleur préprocesseur CSS pour votre application web
Publié: 17/01/2024Conférant style et beauté aux sites internet que nous visitons tous les jours, le langage CSS (Cascading Style Sheets) constitue un pilier essentiel du design web. Malgré cela ...
Lire la suite
Développement web/mobile : Application web VS Application mobile
Publié: 01/09/2023Site internet ou application mobile ? Quelle solution choisir pour donner la meilleure visibilité à son produit et répondre efficacement aux besoins des utilisateurs ? De nos ...
Lire la suite
Sous-traitance informatique : Choisir une agence web au Maroc
Publié: 01/09/2023Après avoir passé en revue les critères de choix d’une agence web qui vous corresponde, vous avez retenu une société de développement basée au Maroc? Bonne idée, mais ...
Lire la suite
Sous-traitance informatique : Bien choisir son agence web
Publié: 01/09/2023Vous souhaitez créer une application web ou mobile, mais vous manquez des compétences techniques pour les réaliser. Faire appel à des professionnels du domaine? Bonne idée ! Mais …
Lire la suite